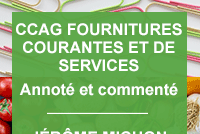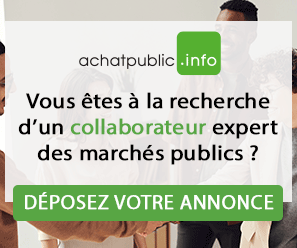[Interview] Jérôme Michon : CCAG : "Il est indispensable d’adapter ses clauses contractuelles aux contingences locales"
Cet article fait partie du dossier :
Document contractuel : CCAG 2021
Jérôme Michon et achatpublic.info s'associent à nouveau pour mettre à votre disposition les CCAG commentés, dans une nouvelle édition. Pour le président de l’Institut de la Commande Publique, une nouvelle édition était nécessaire. Il note que « de nombreuses modifications intervenues récemment sont tournées vers les intérêts des entreprises... bien plus que ceux des acheteurs publics ».
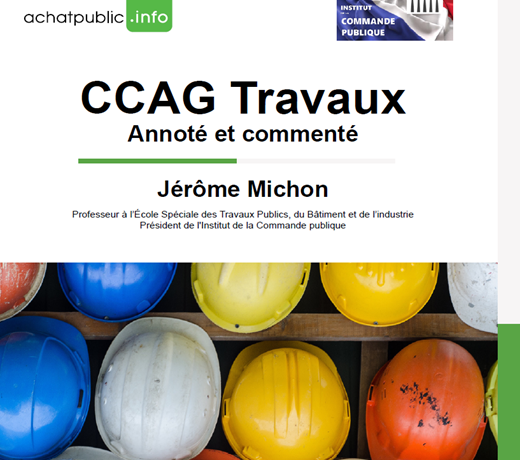
Vous insistez sur l'enjeu d'adaptation locale par les CCAG... C'est à dire ?
Un acheteur peut prévoir un niveau d’exigence très élevé, en termes de clauses sociales, environnementales, voire d’innovation. Mais s’il se trouve sur un territoire où l’intérêt pour la commande publique est très limité, de la part des opérateurs économiques, il risquera de n’avoir aucune offre.
Bien sûr, l’achat public n’est pas un achat local, mais il faut être réaliste : près de 80 % des besoins sont satisfaits par des entreprises implantées dans la région où se situe l’acheteur.La vraie inspiration doit résider dans les CCAG officiels, qu’il convient de faire évoluer cas par cas.
Il est absolument indispensable d’adapter ses clauses contractuelles aux contingences locales, si on veut réaliser des achats efficients. C’est une erreur de recopier des marchés téléchargés sur internet, car ils peuvent constituer de mauvaises sources d’inspiration, inadaptées aux besoins et au contexte dans lequel exerce chaque acheteur. La vraie inspiration doit résider dans les CCAG officiels, qu’il convient de faire évoluer cas par cas.
Quels sont les principaux points qui ont été modifiés dans les CCAG ?
Jérôme Michon - On peut remarquer que de nombreuses modifications intervenues récemment, sont tournées vers les intérêts des entreprises, bien plus que ceux des acheteurs publics. C’est le cas, par exemple, du relèvement à 30 % du taux minimum des avances dans le cadre de l’option A. Cela concerne uniquement les établissements administratifs de l’Etat autres que les établissements publics de santé, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros. Le taux minimal demeure à 5 % pour les autres acheteurs, mais on ne cesse de les inviter à prévoir des taux plus élevés.De plus, le délai prévu pour la résiliation d’un marché de travaux suite à un ordre de service tardif, a été réduit de six mois à seulement quatre mois. Il en est de même du délai à partir duquel le titulaire peut se prévaloir d’un préjudice à ce titre.
Différents toilettages rédactionnels sont aussi intervenus ici ou là, comme la correction d’une erreur de dénomination concernant le "Building Information Modeling", connu sous le sigle "BIM".
Les praticiens ne doivent pas se contenter de renvoyer à un type de CCAG. Il leur est conseillé de mentionner également la date de la version en vigueur
C’est d’ailleurs, la raison pour laquelle nous considérons que les praticiens ne doivent pas se contenter de renvoyer à un type de CCAG. Il leur est conseillé de mentionner également la date de la version en vigueur : celle figurant en l’état, à la date du lancement de la consultation ; ou à la date de notification du marché entraînant naissance juridique de celui-ci ; ou à la date d’établissement des offres, à savoir de la date limite de réception des plis ; ou à une date précise. Car parfois, un différend intervenu en cours d’exécution peut porter sur un article qui a été modifié ; et d’autres modifications ne sont pas exclues.
Quels sont les manques ou incohérences qui subsistent ?
Jérôme Michon - Il en y a plusieurs : tous les CCAG ne prévoient pas la même logique de traitement des manquements des titulaires et de résiliation des marchés, sans que cela repose sur une raison intrinsèque à la nature même du type d’achat concerné.D’autre part, le dispositif sur les pénalités fait l’objet quasiment systématiquement d’une dérogation de la part des acheteurs publics, car il est jugé trop favorable aux entreprises.
Les clauses portant sur le volet « environnemental » et celui « social » sont très développées dans les CCAG, mais elles ne traitent pas suffisamment de l’essentiel, à savoir les mesures coercitives. Il ne suffit pas de prévoir « une » pénalité, ; encore faut-il la définir et cela se traduit bien souvent par une ventilation entre « plusieurs » pénalités (liste à établir). Car on doit s’inscrire dans une logique incitative, qui pousse à une graduation de l’effort, et non pas à l’application d’une seule sanction. Et la performance « environnementale » peut être couplée avec la clause relative à une « prime », en fonction des objectifs atteints, or les CCAG n’envisagent aucunement cette hypothèse.
On peut remarquer également que la notion d’ « avenant » refait surface dans des CCAG au rédactionnel « à la Française », que le Code de la commande publique fidèle aux termes des directives européennes n’avait pas repris lors de sa récente refonte. Bien sûr, les praticiens parlent d’avenant ; mais cette terminologie est trompeuse : il existe plusieurs types d’ « actes modificatifs » selon le droit européen intégré dans notre code, et tous ne découlent pas sur l’établissement d’un « avenant ». Certains « actes modificatifs » sont « unilatéraux » (simple décision ou notification de l’une des parties contractantes) et d’autres sont « bilatéraux » (donc logique d’avenant). Soutenir l’inverse reviendrait à défendre l’aberration qu’il faut établir un « avenant » pour appliquer une simple clause de réexamen, dont relève les clauses de révision de prix. Or une clause de variation (actualisation ou révision) s’applique sans la nécessité de conclure un « avenant ».
On demeure très critique sur les différents cas évoqués dans les CCAG où un « avenant » devrait être conclu. D’ailleurs, les praticiens fonctionnent autrement et n’ont pas recours à autant de cas de formalisation par avenant. Il est conseillé de toiletter (et donc de déroger) les hypothèses figurant dans les CCAG, afin d’éviter toute lourdeur administrative inutile.Les praticiens fonctionnent autrement et n’ont pas recours à autant de cas de formalisation par avenant. Il est conseillé de toiletter (et donc de déroger) les hypothèses figurant dans les CCAG, afin d’éviter toute lourdeur administrative inutile.
Nous pensons également que la liste des pièces à valeur contractuelle figurant dans les CCAG n’est pas établie de manière pertinente. Il convient d’y déroger systématiquement et de dresser cas par cas, la liste la plus adaptée.
Crise sanitaire, augmentation des coûts, pénuries de matériaux : est-ce que les CCAG se sont révélés être efficaces ?
Jérôme Michon - Cette question reflète l’idée que l’on attendrait des CCAG de palier les manquements de la réglementation en vigueur. Et cela sous-entend également que les CCAG, et donc les CCAP y renvoyant, doivent évoluer dans le temps, au cours de l’exécution d’un même marché … comme si la contractualisation d’un échange de consentement devait prévoir toutes les hypothèses exceptionnelles, et nécessairement évoluer dans le temps. Cela reviendrait à ériger le recours à un acte modificatif, comme « normalité » pour la « vie d’un contrat ».
Si on regarde chaque point que vous évoquez, on constate que :
- la crise sanitaire relève de circonstances exceptionnelles, qui justifient parfois de mettre de côté les termes d’un marché, et donc d’aller bien au-delà des clauses d’un CCAG (cela peut concerner les clauses techniques du marché, CCTP ou même BPU / DPGF…) ; et le Code de la commande publique a été modifié à cet égard ;
- les augmentations des coûts (suite au conflit armé en Ukraine) relèvent en réalité de la jurisprudence liée à la théorie de l’imprévision, que l’on ne pense pas être opportun d’institutionnaliser dans un texte normatif (car il faut laisser aux magistrats une appréciation cas par cas, au regard des justificatifs présentés et circonstances invoquées). Le Code de la commande publique se contente de la mentionner, sans la traduire plus en détail. Les CCAG mélangent quant à eux les terminologies : on y parle parfois de « cas de force majeure » (ce qui n’a rien à voir avec « l’imprévision »), de « circonstances imprévues » (ce qui n’est pas la même chose que les « circonstances exceptionnelles » définies dans le Code), de « survenance de difficultés ou de circonstances imprévues en cours de chantier » (ce qui renvoi à un niveau bien plus faible de problématique d’exécution), ou encore d’ « urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles » (ce qui renvoi encore à un autre concept qui est propre à l’urgence impérieuse), etc.
- S’agissant des pénuries de matériaux que vous évoquez, c’est à l’opérateur économique d’en apporter la preuve, de proposer une solution alternative, et à l’acheteur d’en apprécier le bienfondé et l’adéquation à son niveau d’exigence qui a prévalu lors de la sélection des entreprises. Attention, à l’invocation (très courante) par les entreprises d’un « cas de force majeure », car ce concept peut déboucher sur une résiliation du marché et non pas sur sa poursuite selon de nouvelles conditions. Les entreprises titulaires font souvent état de « cas de force majeure » sans avoir conscience du traitement juridique qu’une telle argumentation peut entraîner.
Quels conseils prodiguez-vous aux praticiens quant au « bon usage » de ces CCAG (achat durable, clause d’insertion, cyber-attaques, révisions de prix …) ?
Jérôme Michon - Les CCAG constituent des référentiels très utiles pour l’établissement de clauses contractuelles ad hoc. Ils doivent permettre de s’interroger sur la pertinence de tel ou tel dispositif dans un marché spécifique. Mais ils ne constituent jamais une fin en soi : d’ailleurs, les CCAG eux-mêmes renvoient à des compléments que les clauses particulières doivent prévoir. Ils ne faut donc pas les voir comme étant une finalité, mais simplement comme étant une base rédactionnelle.Sans être présentement exhaustif, on pourrait dire qu’il est conseillé de déroger systématiquement aux clauses relatives à l’exigence environnementale et/ou sociale (en adaptant le niveau d’exigence selon le type de marché et le contexte dans lequel exerce l’acheteur), aux pièces à valeur contractuelle (la liste prévue dans les CCAG n’est pas efficiente), aux variations de prix (c’est à adapter cas par cas, et même parfois, lot par lot), aux pénalités (il en manque … il faut en établir une liste plus ciblée), aux règlements des litiges et différends (car, outre la mention du tribunal compétent, il peut être opportun de prévoir un dispositif de règlement amiable du différend obligatoire, avant tout recours contentieux), etc.
Pensez-vous que les acheteurs publics se sont bien appropriés ces nouveaux CCAG ?
Jérôme Michon - En pratique, la plupart des acheteurs renvoient dans leurs marchés publics à un CCAG, tout en dérogeant de manière plus ou moins pertinente à de nombreuses clauses. Donc, on peut confirmer leur bonne appropriation.Mais le problème est plutôt du côté des « messages » que cette réforme des CCAG a véhiculé : les pouvoirs publics ont clairement mis l’accent en faveur des opérateurs économiques et beaucoup moins en faveur des entités acheteuses. Et cela a été entendu comme tel par bien des entreprises du BTP … au point qu’elles prennent pour argent comptant ce qui figure dans le CCAG Travaux, en oubliant les clauses qu’elles ont pourtant signé avec leurs maîtres d’ouvrage. Il serait opportun que les soumissionnaires lisent (toutes) les pièces d’un dossier de consultation, avant de soumissionner. Cela éviterait leur découverte en cours d’exécution.
Certains commentateurs ont salué ces récentes réformes des CCAG, comme étant une opération de rééquilibrage des droits et obligations entre les parties contractantes. Or cette problématique d’équilibre entre les parties est, à nos yeux, hors sujet, puisque la nature même d’un marché public repose sur la présence de prérogatives de puissance publique, qui institutionnalisent un certain déséquilibre (ne serait-ce qu’à travers le droit à une résiliation unilatérale de la part de l’acheteur).Certains commentateurs ont salué ces récentes réformes des CCAG, comme étant une opération de rééquilibrage des droits et obligations entre les parties contractantes. Or cette problématique d’équilibre entre les parties est, à nos yeux, hors sujet, puisque la nature même d’un marché public repose sur la présence de prérogatives de puissance publique, qui institutionnalisent un certain déséquilibre
Quoi qu’il en soit, on soulignera une certitude : les CCAG (quelle que soit leur réforme) ne remplaceront pas l’intelligence des acheteurs publics qui doivent constamment en adapter leur contenu, afin de réaliser un « bon achat ». Et on sait que l’on peut compter sur eux.
Une des pistes évoquées pour sortir de la crise des assurances des collecivités territoriales, c'est la publication d'un CCAG dédié aux marchés publics d'assurance. Cela vous semble-t-il opportun?
Jérôme Michon - Je suis un peu sceptique, et ce, pour deux raisons.
D'abord, le secteur des assurances est très spécifique et répond à des règles qui sont parfois difficilement compatibles avec celles du Code de la commande publique. C'est le seul marché où la possibilité pour les candidats de formuler des "réserves" à un cahier des charges établi par un acheteur constitue la règle de droit commun. C'est même institutionnalisé, à tel point que certains assureurs dérogent en totalité au cahier des charges (qu'il soit un CCAP ou CCTP) de la collectivité, et imposent la signature de leurs propres contrats (bien souvent, c'est une pratique de la part des courtiers qui renvoient au contrat type de leur assureur). Certains ne signent même pas l'acte d'engagement de la collectivité, mais présentent leur propre document. La logique rédactionnelle est donc parfois ainsi complètement inversée. Ce qui est regrettable et pas normal.
La deuxième raison de mon scepticisme réside dans la diversité des besoins des collectivités en assurance : le véritable sujet d'un marché public d'assurance se trouve ailleurs que dans l'établissement d'un CCAP (qui renverrait à un CCAG fusse-t-il dédié aux services d'assurance).
Il se trouve dans la réalisation d'un état des lieux, dans le recensement du patrimoine à assurer (immobilier, mobilier, flotte automobile, etc.). Or, par expérience, nous pouvons constater que bien des administrations ne disposent pas d'un recensement exhaustif et fiable, et n'ont pas mis à jour - au fil du temps - l'étendue de la couverture de leur contrat d'assurance. Je connais un bailleur social qui a payé une prime d'assurance pendant des années, pour des bâtiments démolis.
Et plus généralement, j'aurai tendance à dire que la rédaction d'un CCAG reviendrait à régler la question de la résiliation unilatérale d'un marché public d'assurance. Or, j'ai bien peur que la tendance penche en faveur d'un rédactionnel favorable aux assureurs (en vertu des termes du Code des assurances) et revienne à contester le bienfondé d'une jurisprudence récente, et beaucoup nuancée, du Conseil d'Etat.
Ce dernier a limité le droit de résiliation unilatérale des assureurs, versus celui dont disposent les administration en vertu de prérogatives de puissance publique. Et je pense que les magistrats ont raison, en ayant trouvé ce "juste milieu", qui assure une cohabitation (et non un conflit de droits) entre le Code des assurances et le Code de la commande publique.
A télécharger gratuitement :
- CCAG Travaux, annoté et commenté par Jérôme Michon
- CCAG Maîtrise d’œuvre annoté et commenté par Jéôme Michon
- CCAG Techniques de l’Information et de la Communication
- CCAG Prestations intellectuelles annoté et commenté
- CCAG Fournitures courantes et Services annoté et commenté
Sur le même sujet


Envoyer à un collègue
Chargé de marchés publics (f/h)
- 24/04/2025
- ETP Plaine Commune
Chargé d'études commande publique durable et solidaire (f/h)
- 22/04/2025
- Caen la mer Normandie
- 15/04/2025
- CADI
TA Toulouse 3 mars 2025 Société Toopi Organics
-
Article réservé aux abonnés
- 25/04/25
- 11h04
TA Lyon 7 mars 2025 Société Options Solutions
-
Article réservé aux abonnés
- 23/04/25
- 07h04
TA Toulon 6 mars 2025 Société Union des producteurs locaux d'électricité
-
Article réservé aux abonnés
- 22/04/25
- 07h04
Acheteurs publics : les trouver, c’est compliqué ; les garder, c’est pire !
-
Article réservé aux abonnés
- 17/04/25 06h04
- Jean-François Aubry
Le B.A -BA de l’achat – La sous-traitance
-
Article réservé aux abonnés
- 16/04/25 06h04
- Etienne Ducluseau
Accord-cadre multi-attributaires : pas de droit à l’information pour les attributaires de second rang ?
-
Article réservé aux abonnés
- 24/04/25 06h04
- Mathieu Laugier
[Au plus près des TA] Des conflits d’intérêts sans incidences, le Code de la commande publique respecté
-
Article réservé aux abonnés
- 22/04/25 06h04
- Nicolas Lafay
-
Article réservé aux abonnés
- 17/04/25
- 06h04